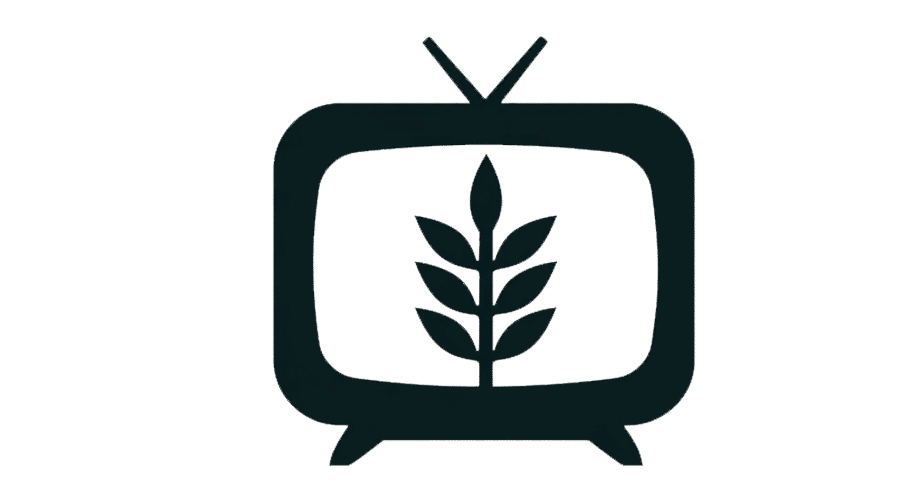Les zones de non-traitement (ZNT) occupent désormais une place de choix dans les débats animant l’agriculture française. Ces espaces, où l’utilisation des produits phytopharmaceutiques se fait, en certains endroits, plus ténue, ont pour finalité de préserver la qualité de l’eau et, dans une certaine mesure, de renforcer la santé publique.
Tenter de cerner précisément ce que recouvre leur définition, les conséquences plus ou moins immédiates qu’elles impliquent, ainsi que les adaptations de pratiques qu’elles suscitent, voilà qui nourrit la réflexion aussi bien parmi les agriculteurs que chez de nombreux riverains.
D’ailleurs, il y a un an, une réunion improvisée chez un exploitant de l’Oise avait même rassemblé élus et voisins autour d’une carte IGN, preuve manifeste que cette thématique suscite bien des questionnements et relance régulièrement les discussions sur la gestion du territoire local.
Résumé des points clés
- ✅ Les ZNT limitent l’usage des produits phytosanitaires pour protéger l’eau et la santé.
- ✅ Les distances de protection varient selon la culture et le produit utilisé.
- ✅ Les pratiques agricoles doivent s’adapter pour rester conformes à la réglementation.
Sommaire
Les distances de sécurité dans les zones de non-traitement
Les ZNT imposent des distances minimales à observer lors de l’épandage de produits phytosanitaires : qu’il s’agisse d’un champ céréalicole ou du cœur d’une parcelle de vigne, tout dépend du produit et du type de culture concernée : il convient de respecter 20 mètres incompressibles pour les substances CMR1 ou celles identifiées perturbateurs endocriniens.
10 mètres incompressibles pour les substances CMR2, et aussi 10 mètres pour l’arboriculture ou la viticulture – une règle évolutive qui fait parfois débat lorsqu’il s’agit de l’adapter aux cas particuliers (les discussions de terrain en témoignent).
Pour d’autres cultures, le seuil de 5 mètres devient accessible à condition de remplir certains critères techniques.
Ces distances servent à encadrer non seulement la proximité des points d’eau, mais aussi des habitations et zones où se trouvent des publics fragiles.
Il est parfois bon de rappeler que les ZNT s’adressent à tous les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques : agriculteurs, collectivités, simples particuliers – personne n’y échappe vraiment.
Les points d’eau concernés sont en général définis par arrêté préfectoral : sont compris aussi bien les cours ou plans d’eau naturels, que certains fossés ou segments du réseau hydrographique inscrits sur la carte.
Pour réduire le risque d’oubli ou d’interrogation lors des campagnes de traitement, les services de l’État proposent des cartographies très détaillées des secteurs soumis à restriction : un réflexe encore régulièrement avant d’attaquer la nouvelle saison d’épandage.
Bon à savoir
Je vous recommande de consulter systématiquement la cartographie officielle avant chaque campagne de traitement pour éviter toute erreur réglementaire.
Adapter ses pratiques agricoles aux ZNT
L’arrivée des ZNT oblige fréquemment à revoir certaines méthodes.
Ce n’est toutefois pas toujours immédiat ni linéaire.
Plusieurs options s’offrent pour garantir la continuité de production tout en restant conforme aux nouvelles normes : par exemple, abaisser les distances (de 10 à 5 mètres) en délimitant une bande végétalisée d’au moins 5 mètres, investir dans du matériel adapté limitant la dérive, ou encore, adhérer à une charte départementale reconnue.
Passage au biocontrôle, recours à des solutions à faible risque ou substances de base : ces alternatives sont désormais monnaie courante dans la bouche des techniciens comme des exploitants et, parfois, elles permettent d’obtenir des dérogations – une véritable nouveauté qui change le quotidien au champ.
Une autre piste – fréquemment encouragée – consiste à privilégier les cultures à bas niveau d’intrants (BNI), généralement moins consommatrices de traitements phytosanitaires (cette voie trouve un certain écho en bocage), ce qui facilite le respect réglementaire sans freiner l’exploitation.
Valoriser les prairies, en temporaire ou permanent, offre aussi de vrais bénéfices : certains y voient une opportunité de relancer la biodiversité, effet apprécié sur le long terme.
De manière indirecte, l’implantation d’une ZNT invite aussi, parfois, à réviser les pratiques d’élagage des arbres en lisière de parcelle : opter pour la douceur ou le progressif contribue alors à préserver l’équilibre écologique – une nuance qui ressort parfois lors d’audits environnementaux (même si elle ne saute pas toujours aux yeux au premier abord).

Accompagnement et aides pour les agriculteurs
L’application des ZNT bouscule les habitudes et questionne surtout quand le contexte économique resserre les marges.
Pour franchir le pas, plusieurs soutiens existent aujourd’hui : MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques), qui facilitent l’adoption de nouvelles pratiques ; dispositifs de financement pour l’équipement (pulvérisateur, buses anti-dérive ; la liste évolue), ou encore l’accompagnement par les réseaux techniques DEPHY, qui accompagnent la réduction des phytosanitaires.
Parfois, une simple visite ou un échange avec un conseiller technique suffit à débloquer une voie jusque-là inexplorée.
| Solution | Avantages | Limites |
|---|---|---|
| MAEC |
|
|
| Aides à l’équipement |
|
|
| Réseaux DEPHY |
|
|
L’objectif : faciliter l’accès aux pratiques plus durables, sans toutefois déséquilibrer les modèles économiques locaux.
La requête pour ces aides passe le plus souvent par la chambre d’agriculture ou les services locaux de l’État : la procédure administrative demande parfois de la patience, mais peut, à terme, améliorer sensiblement la situation sur l’exploitation.
En parallèle, diverses formations apparaissent pour permettre d’avancer sur la gestion des alternatives, l’amélioration des traitements ou la réorganisation des rotations.
Certaines sont victimes de leur succès lors des campagnes de printemps ou d’automne : la transmission d’expérience entre agriculteurs y prend, bien sûr, toute sa place et peut s’avérer très enrichissante.
Dialogue et concertation autour des ZNT
La présence des ZNT rend indispensable un dialogue continu entre agriculteurs, riverains, élus, mais aussi – parfois – citoyens regroupés.
Qu’il s’agisse d’un entretien au bord d’un champ ou d’une rencontre formelle à la mairie, l’important reste d’identifier des compromis adaptés au contexte, et de prévenir, ici et là, la montée des tensions.
Une animatrice associative du Sud-Ouest glissait récemment qu’envoyer simplement un SMS ou une lettre avant le traitement avait, à l’échelle locale, grandement rasséréné les échanges.
Les chartes d’engagement départementales, issues d’une co-construction avec validation préfectorale, sont centrales : elles précisent les horaires d’intervention, la diffusion de l’information vers les riverains, les règles du bon voisinage – cette trame pouvant naturellement varier d’un coin à l’autre selon la réalité du terrain.
En cas de désaccord prolongé, la conciliation s’offre encore comme possibilité : on recherche alors une issue conforme à la loi qui tienne compte des situations concrètes.
Autre effet d’entraînement : la dynamique ZNT s’étend parfois aux jardins collectifs ou familiaux, où la création d’espaces sans traitement chimique autour des enfants gagne du terrain un peu partout.
Impacts et perspectives des ZNT
L’apparition des ZNT s’inscrit dans une volonté plus large : préserver les ressources vitales et la santé, tout en cultivant le calme dans le tissu rural.
Parmi les effets déjà remarqués par les professionnels : une baisse des polluants dans l’eau, un regain pour la biodiversité, et moins d’exposition aux produits chimiques parmi les riverains comme les travailleurs agricoles.
À souligner que de nombreux témoignages mettent en avant l’ouverture du dialogue sur les alternatives, aussi bien chez les nouveaux installés que chez les exploitants plus expérimentés.
Côté filière, les ZNT pourraient, à court, moyen ou long terme, accélérer l’arrivée de modèles novateurs : développement de la protection intégrée, croissance du biocontrôle, échanges en ligne entre agriculteurs… Autant de dynamiques qui redessinent peu à peu les pratiques.
La question de l’équité régionale et de l’articulation européenne risque de se poser avec encore plus d’acuité pour les zones proches des frontières ou en altitude.
En résumé, les zones de non-traitement installent un véritable changement d’ère dans l’agriculture française.
Austères au démarrage, ces exigences orientent néanmoins vers une agriculture à la fois plus résiliente, attentive à ses voisins et à son environnement.
Reste à chacune et chacun de s’investir progressivement dans cette dynamique – pour qu’elle s’enracine durablement au fil des saisons, et continue à rassembler sur le territoire, quelles que soient les différences de parcours.
Mis à jour le 2 juillet 2025