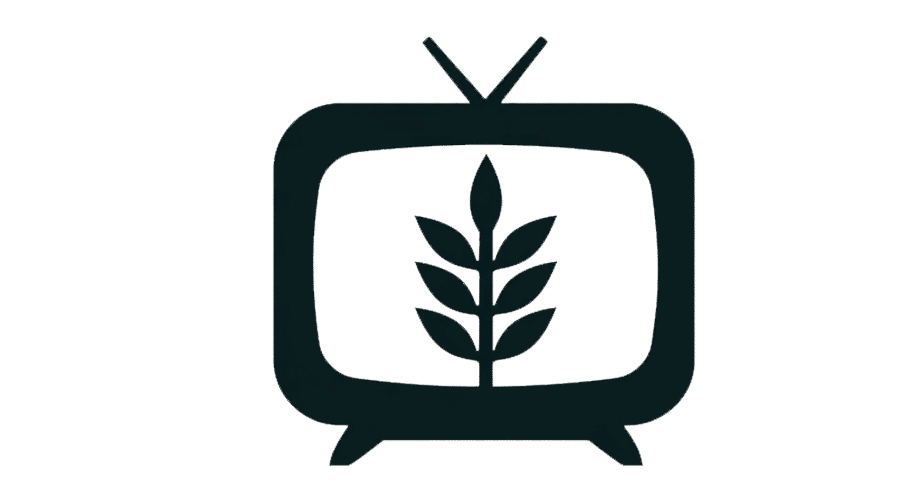L’indice national des fermages 2024 vient tout juste d’être publié, marquant une hausse significative de 5,23 % par rapport à l’an passé. Cette augmentation agit directement sur le montant des loyers des terres agricoles pour la période comprise entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025.
Prenons un moment pour détailler ce mouvement : ses rouages et surtout, ses effets tangibles sur les baux ruraux.
Résumé des points clés
- ✅ L’indice national des fermages 2024 affiche une hausse de 5,23 %.
- ✅ Ce nouvel indice impacte directement le montant des loyers agricoles.
- ✅ La méthode de calcul et d’application varie selon les départements.
Sommaire
Comprendre l’indice fermage 2024 et son application
L’indicateur fermage pour 2024 atteint 122,55, contre 116,46 en 2023. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique haussière durable, observable déjà depuis l’année 2018. Bon à savoir : ce chiffre sert de repère pour actualiser le montant des loyers des terres agricoles. Rien d’anodin là-dedans : c’est chaque année un vrai baromètre surveillé par tous les acteurs de la filière.
Bon à savoir
Je vous recommande de vérifier chaque année le nouvel indice pour adapter vos loyers selon la réglementation en vigueur.
Le mode de calcul de ce barème repose sur une base mixte : 60 % de l’évolution du revenu brut d’exploitation agricole et 40 % liés à la variation du Produit Intérieur Brut (PIB). Cette formule, entérinée par arrêté ministériel du 17 juillet 2024, a pour but de coller au mieux à la réalité du secteur agricole.
Petite précision : la base 100 correspond à l’année 2009, ce qui permet de comparer les variations sur la longueur — certains bailleurs utilisent d’ailleurs cette référence pour suivre la tendance décennale.
Côté propriétaires ou exploitants, appliquer ce nouvel indice consiste souvent à adapter le montant des fermages. Plusieurs approches sont possibles : multiplier le fermage 2023 par 1,0523, utiliser la formule (Fermage 2023 × 122,55) / 116,46, ou recalculer depuis 2009 avec (122,55 / 100). À chacun sa logique de calcul, mais l’enjeu demeure une mise à jour équitable des baux ruraux.
Précisons que, sur le terrain, certaines coopératives ou organismes agricoles québécois proposent parfois des outils de calcul spécifiques pour faciliter la tâche.
Evolution historique de l’indice national des fermages
Pour bien situer ce mouvement, un retour sur les chiffres des dernières années s’impose. Voici un aperçu qui aide à mieux prendre la mesure du phénomène :
| Année | Indice |
|---|---|
| 2009 | 100,00 |
| 2010 | 98,37 |
| 2011 | 101,25 |
| 2022 | 110,26 |
| 2023 | 116,46 |
| 2024 | 122,55 |
Cette progression illustre la dynamique du secteur agricole, tout en rappelant l’impact de nombreux facteurs extérieurs sur les loyers : météo, inflation, marchés mondiaux…
Depuis 2018, la hausse s’est installée sur la durée, malgré certains obstacles inévitables au passage. Certains attribuent, par exemple, l’influence de la météo de l’été 2022 sur les résultats affichés en 2023.
De plus, on remarque que les évolutions ne dessinent pas toujours une courbe tranquille : de fortes variations peuvent apparaître d’une campagne à l’autre, qu’il s’agisse de caprices climatiques, de remaniements réglementaires, ou encore de changements au niveau international.

Impact sur les baux ruraux et modalités d’application
L’indice actualisé de 2024 produit des répercussions immédiates sur les contrats de location de terres agricoles. Sont concernés aussi bien les terres nues que les bâtiments d’exploitation.
Remarque importante : la façon dont l’indice s’applique varie, parfois sensiblement, d’un département à l’autre. Il est donc conseillé de consulter les arrêtés locaux, surtout si l’exploitation couvre plusieurs communes, ce qui peut sembler anodin mais s’avère fondamental.
En réalité, chaque arrêté préfectoral peut préciser la date d’entrée en vigueur, fixer des repères de prix selon la culture (blé, betteraves, lait, etc.), ou prévoir des adaptations correspondant aux conditions régionales.
Ce pilotage de proximité explique l’intérêt, pour bailleurs et preneurs, de se tenir informés des réglementations locales qui évoluent régulièrement.
Ce contexte fait émerger quelques questions très concrètes : comment revoir les loyers dans la pratique ? Quelles démarches faut-il prévoir ? On peut résumer les grandes étapes ainsi :
- ✅ Information mutuelle : Le bailleur informe le preneur qu’une révision du loyer s’applique sur la base du nouvel indice.
- ✅ Calcul du nouveau montant : Il s’appuie sur l’une des formules présentées ci-dessus pour procéder à l’ajustement.
- ✅ Accord des parties : En principe, bailleur et preneur se mettent d’accord ensemble sur le nouveau montant, souvent après vérification croisée.
- ✅ Formalisation : Mieux vaut acter l’accord par écrit, même si la loi ne l’exige pas à chaque fois. Cela sécurise en cas de contestation par la suite.
- ✅ Application : Le nouveau loyer s’applique à la date précisée par le préfet ou, à défaut, dès le 1er septembre 2024.
Cette revalorisation pèse, parfois lourdement, sur l’équilibre financier de bon nombre d’exploitations. Pour certains, c’est une charge supplémentaire à inclure dans le budget, alors que la rentabilité reste souvent très fragile, notamment dans les filières exposées aux effets économiques ou liés à l’environnement.
Perspectives et enjeux pour le secteur agricole
L’évolution de l’indice s’inscrit dans une séquence bien plus large de mutations profondes pour l’agriculture. Cette hausse ne manquera pas de soulever des interrogations sur la stabilité économique des exploitations, ainsi que sur l’attractivité d’un métier déjà soumis à de nombreux imprévus.
Quatre grandes thématiques apparaissent : adaptation continue des modèles pour absorber la hausse des charges ; nécessité d’un dialogue ouvert et équilibré entre propriétaires et exploitants ; importance de politiques d’accompagnement adaptées (on remarque qu’elles restent souvent mal connues) ; et enfin une réflexion sur des mécanismes de sécurisation aptes à lisser les revenus agricoles sur le moyen ou long terme.
Certaines régions proposent déjà des dispositifs très ciblés, parfois encore confidentiels.
En arrière-plan, la progression de l’indice peut aussi peser sur le marché du foncier rural. Certains propriétaires envisageront sans doute d’ajuster leur stratégie d’investissement ; tandis que les jeunes agriculteurs risquent, eux, de voir l’accès au foncier se complexifier quelque peu.
Cette question a animé de nombreux débats lors de négociations départementales récentes.
Dans un tel contexte, la mobilisation de tous les acteurs – producteurs, bailleurs, organismes professionnels, collectivités et pouvoirs publics – semble plus que jamais nécessaire pour aboutir à des compromis équilibrés. L’objectif reste, somme toute : garantir une rémunération juste du foncier sans affaiblir la viabilité des exploitations, dans un univers agricole déjà marqué par l’incertitude.
L’indice fermage 2024 marque, à sa façon, un vrai tournant pour le secteur agricole en France. Plus qu’une simple actualisation des loyers : il pourrait durablement influencer, et peut-être transformer en profondeur, l’organisation des exploitations et les équilibres à venir dans les campagnes.
Mis à jour le 2 juillet 2025