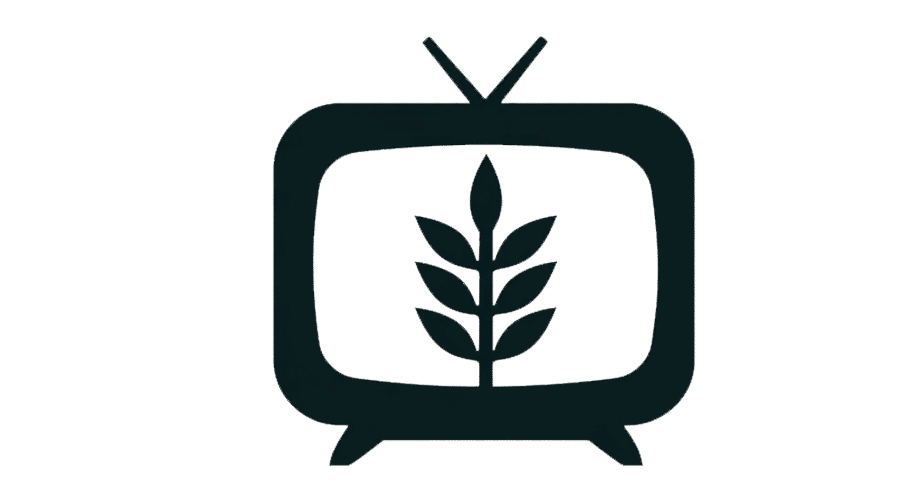Vos thuyas, cyprès ou chamaecyparis perdent peu à peu leur éclat. Des zones jaunissent, d’autres deviennent grisâtres, comme couvertes d’un voile. En inspectant de plus près, vous découvrez de fines toiles entre les rameaux, et des points rouges qui s’agitent à peine. Ce ne sont pas des araignées à huit pattes, mais bien des acariens tisserands — les fameuses araignées rouges. Très actifs en été, ils peuvent ruiner une haie entière en quelques semaines. Pourtant, une solution existe, simple et naturelle : lâcher avant le 5 août leur principal prédateur, Phytoseiulus persimilis.
Sommaire
Comment reconnaître une attaque d’araignées rouges sur les conifères ?
Les premiers signes apparaissent discrètement : des décolorations, un feuillage terne, piqueté, puis des filaments soyeux sur les branches.
Les araignées rouges ne sont pas des insectes, mais des acariens. Leur nom exact : tétranyques. Ils piquent les cellules végétales pour s’en nourrir, provoquant une déshydratation progressive du feuillage. Plus l’été est chaud et sec, plus leur prolifération s’accélère. Si vous secouez une branche au-dessus d’une feuille blanche, vous verrez de minuscules points rouges en mouvement : l’infestation est bien là.
Pourquoi agir avant le 5 août contre les araignées rouges ?
Le seuil du 5 août correspond à la montée en puissance des infestations, souvent favorisée par les fortes chaleurs et l’air sec d’août.
Dès que la température dépasse 25 °C, les araignées rouges se reproduisent toutes les 3 à 5 jours. Passé le début août, leur population peut exploser, et les conifères souffrent plus durablement. Intervenir avant cette date, c’est prendre de l’avance sur la courbe, au moment où les prédateurs naturels comme Phytoseiulus persimilis peuvent encore contrôler efficacement la situation.
Qu’est-ce que Phytoseiulus persimilis et comment agit-il ?
Phytoseiulus persimilis est un acarien prédateur, spécialisé dans la chasse aux araignées rouges. Il ne s’attaque qu’aux tétranyques, à tous leurs stades de développement.
Contrairement aux traitements chimiques, ce prédateur ne laisse aucun résidu, ne perturbe pas l’équilibre biologique du jardin, et s’autorégule. Il est invisible à l’œil nu mais redoutablement efficace : une fois lâché, il explore les zones infestées, perce les œufs, dévore les larves, et élimine les adultes. Lorsqu’il n’a plus de proies, il meurt naturellement. Aucun risque de déséquilibre ou de surpopulation.
Comment utiliser Phytoseiulus persimilis sur les conifères ?
Le lâcher se fait directement sur les zones infestées, en début de matinée ou en soirée, lorsque l’humidité est suffisante et la température modérée.
Il est recommandé de brumiser légèrement les feuillages avant et après le lâcher. Phytoseiulus aime une ambiance humide (60 à 75 % d’hygrométrie) et des températures entre 15 et 30 °C. Une dose de 5 à 10 prédateurs par mètre carré suffit dans la plupart des cas. Pour les grandes haies, on répartit les acariens en plusieurs points, ou via de petits sachets accrochés à l’intérieur du feuillage.
Faut-il répéter le lâcher ou l’associer à d’autres méthodes ?
Un seul lâcher peut suffire si l’infestation est modérée. En cas de chaleur persistante ou de récidive, une deuxième introduction est utile à 7 jours d’intervalle.
On évite les insecticides, même naturels, qui tueraient aussi les acariens bénéfiques. L’important est de maintenir de bonnes conditions pour leur développement : brumisation régulière, paillage au pied pour conserver l’humidité, et absence de traitements chimiques. Il est également utile de surveiller les plantes voisines (rosiers, lauriers, fusains), souvent colonisées en parallèle.
Quels résultats espérer après le lâcher ?
Les premiers effets sont visibles sous une semaine : les toiles se raréfient, le feuillage cesse de blanchir, et les nouvelles pousses retrouvent leur tonus.
Phytoseiulus persimilis agit rapidement, mais les parties gravement atteintes restent sèches. Ce prédateur stoppe l’évolution de l’infestation, mais ne répare pas les dégâts déjà causés. Une taille légère des zones mortes peut aider la plante à repartir. S’il est lâché assez tôt — avant le 5 août — il permet souvent d’éviter une défoliation massive ou une perte irréversible des rameaux.
Ce petit acarien, invisible mais indispensable, transforme une lutte chimique frustrante en une régulation biologique simple, durable et ciblée. Encore faut-il agir au bon moment, quand la chaleur n’a pas encore tout brûlé, et que les conifères ont encore de la sève à défendre.
Mis à jour le 21 juillet 2025